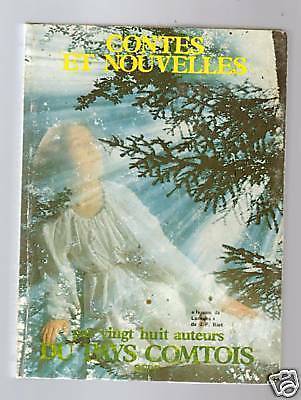CONTES & NOUVELLES DU PAYS COMTOIS.
LE MIRACLE DU BOIS MORT et 1 autre nouvelle.
LE MIRACLE DU BOIS MORT
à Marie-Thérèse Dubler
Au travers des carreaux fendus constellés de mille arabesques par le gel de Décembre, un rayon de soleil pénétrait dans la cuisine, et sa caresse à peine tiède effleurait les cheveux blonds de la fillette. Assise à la table, un châle troué sur les épaules, la petite lisait.
Depuis la chambre dont la porte demeurait ouverte en permanence, une voix sans force appela :
- Kattle !
La gamine repoussa son livre et se leva en rejetant ses nattes d’un revers de main. Elle entra dans la pièce où le papier, naguère peint de lys bleus, se décollait par lambeaux.
- Que veux-tu, mutty ? Demanda-t-elle doucement.
Dans le lit-cage au-dessus duquel une mauvaise peinture à l’huile esquissait l’hiver, une jeune femme respirait bruyamment. Des volutes de buée filtraient entre ses lèvres pâles. Deux longues tresses d’or encadraient son visage amaigri, aux joues et aux pommettes enflammées par la fièvre. Elle murmura dans un souffle :
- Tu n’as pas froid, ma chérie ?
- Oh ! mutty, protesta Kattle, c’est plutôt moi qui devrais demander cela !
Faisant mine de ne pas avoir entendu, la mère poursuivit :
- Apporte-moi notre reste d’argent !
Kattle courut vers une commode basse à trois tiroirs sombres. Elle en ouvrit le premier qui gémit en laissant s’évanouir une odeur de naphtaline et de vieille eau de Cologne. Sous un tas de chiffons, elle découvrit un porte-monnaie tout noir en cuir craquelé. Avec peine, la pauvre femme rehaussa son oreiller, prit le désolant butin que lui tendait sa fille et se mit à compter les pièces :
- Six francs, soupira-t-elle ; il y a juste pour redemander le médecin…Mais si je le fais venir, que mangeras-tu ma Caline ?...
La petite, qui ne se nourrissait plus que d’une soupe d’eau froide salée lâchement épaissie d’un croûton de vieux pain écrasé répondit :
- Oh : Je t’en prie, mutty, soigne-toi !
Puis, essayant de mentir à peu près :
- Il reste encore des pommes de terre, des carottes, des haricots de l’oncle Ziller et des…
- Des haricots, reprit Liesel Meyer incrédule.
Kattle se souvint alors de sa mère posant le dernier bocal sur la table, c’était la semaine dernière, elle avait même ajouté :
- Et voilà ! Ce ne sera plus la peine de descendre au garde-manger !
Prise en faute, Kattle baissa la tête en mordillant une de ses nattes.
- Approche, ma chérie, lui dit sa mère.
Kattle vint s’asseoir sur le lit, les lèvres contractées par une moue de menue bonne femme. Liesel Meyer se mit à contempler son enfant : le Grand Architecte de l’Univers avait tracé sa bouche d’un mince coup de crayon, et laissé choir deux gouttes d’azur au fond de la prunelle de ses yeux vifs. Mais qu’advenait-il de cette joie de vivre qui fleurissait naguère sur son visage en corolle de hardiesse ? A force de privations et malgré ses dix ans, Kattle perdait l’insouciante gaieté de l’enfance. Liesel poursuivit :
- Ne te laisse pas manquer de nourriture ! Finalement, ce n’est pas la peine de faire revenir le médecin ; il me reste encore quatre comprimés. Tu prendras les six francs et tu iras chez les voisins acheter du pain et des œufs !
Kattle détourna son regard des yeux enfiévrés de sa mère ; chez les voisins, elle y était allée avant-hier, ils l’avaient
menacée de la battre si elle osait revenir…
Liesel insista :
-
Tu m’écoutes, Kattle ? Demande du pain et des œufs ! Ce soir tu mangeras à ta faim… Ce soir…
Comme la petite ne réagissait pas, Liesel lui tapota la joue :
- Allons, ma Caline, nous sommes le 5 décembre aujourd’hui, la veille de la Saint-Nicolas !
Kattle sentit son cœur se serrer. Elle se souvint des Saint-Nicolas passées à Schiltigheim. La veille au soir, elle plaçait ses souliers près de la porte, et le lendemain matin elle les retrouvait enfouis sous les cadeaux qu’elle déballait, les doigts empêtrés dans les rubans multicolores. Et puis, en ville dès le début de décembre, les vitrines des pâtisseries montraient des Saint Nicolas de toutes les tailles, en pain d’épices, en chocolat ou en massepain. Dans certaines communes, le dimanche qui suivait le 6 décembre, Saint Nicolas parcourait les rues en calèche ou en vieille guimbarde, et distribuait des bonbons offerts par les commerçants ; déjà quatre ans de cela !
Kattle fixait sa mère d’un regard triste. Liesel lui dit tendrement :
- Ne sois pas chagrine : Saint Nicolas est aussi passé pour toi !
Elle tira de dessous son oreille une sorte de pantin, et elle le lui tendit radieuse. Kattle demeura muette devant cette poupée hâtive, faite de toile à matelas, sans pieds ni mains, avec des oreilles de chat, deux boutons à la place des yeux et une touffe de crin en guise de chevelure. La fillette repensa aux poupées du magasin de madame Ziegelmeyer, des poupées aux cheveux d’or vêtues en paysannes de l’ancien temps. Déçue et prête à pleurer, soudain elle revit sa mère lui réclamer du fil et des aiguilles. Un autre jour, alors qu’elle entrait dans la chambre, elle l’avait surprise à dissimuler quelque chose sous ses couvertures. Au bord des larmes Kattle se ressaisit :
- Oh ! mutty : elle est belle, je l’appellerai Cosette, comme la petite fille des Misérables !
Puis elle se jeta dans les bras de sa mère :
- Oh ! mutty, chante-moi, s’il te plaît, la légende de Saint Nicolas !
Malgré le feu qui lui rongeait la poitrine, la jeune femme se mit à fredonner d’une voix faible et cassée :
- « Ils étaient trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs… »
Mais soudain l’air lui manqua. Elle haleta entre deux sanglots.
- Je ne peux plus… Je ne peux plus…
Kattle enfouit sa tête contre la gorge brûlante de sa mère et lui caressa les cheveux.
- Pardon mutty !... Je n’ai rien à te donner et en plus je te fais pleurer…
Dans un souffle de tendresse, la jeune femme murmura encore :
- Oh ! Ma Caline, tu es pour moi le plus beau des cadeaux.
Les yeux de Liesel se noyèrent un instant dans ceux de sa fille, en une de ces communions sublimes qui font trouver si beaux les yeux de l’être aimé. Elle poursuivit, toujours essoufflée :
- Bien sûr, j’aimerais tant qu’au village les gens t’appellent « Catherine » et qu’ils me disent « la Louise »… Comme ils disent « La Jeanne », « la Marguerite », « la Joséphine »… J’aimerais aussi un bon feu dans notre petit fourneau… Un bon feu qui nous réchaufferait au moins cette nuit… Nous n’avons plus de bois depuis trois semaines…
Le visage de Kattle s’éclaira tout à coup et elle s’écria :
- Mutty, tu auras un bon grand feu dans le petit fourneau ! Il reste des planches dans le bucher, elles sont pourries, mais j’arriverai quand même à les faire brûler avec du fagot bien sec. Je cours en chercher !
Kattle saisit une couverture dont elle s’entoura les épaules, baisa le front de sa mère et lui dit :
- Il est trois heures, la forêt n’est pas loin ; je serai de retour avant la tombée de la nuit. J’emporte Cosette avec moi !
Avant de sortir, la fillette s’arrêta devant le calendrier suspendu sur la porte de la cuisine donnant dehors et prononça tout bas :
- Samedi 5 décembre… Samedi 5 décembre 1942…
****
Kattle traversa le village sans glisser par jeu sur le verglas rendu éblouissant par le soleil qui commençait à regagner la crête de la montagne. La lumière des rayons jaunes formait une auréole autour de la silhouette de la petite.
Il faisait froid cet après-midi, comme cette veille de Saint Nicolas 1938 à Schiltigheim. Kattle se promenait dans le grand parc de la Roseraie. Atteint d’un mal incurable, François Meyer marchait au bras de Liesel. Ils s’étaient arrêtés près du chêne séculaire. Dans une plate-bande poussait des roses de Noël. François en cueillit une et dit :
- La vie est ainsi faite : elle paraît belle, puis un jour le destin mêle le mortier à la terre glaise pour empêcher la pâte d’être lisse…
Il effeuillait les pétales et les jetait à ses pieds. Quand il ne resta plus que le cœur de la rose, il le laissa tomber sur le sol enneigé et soupira :
-…et puis un jour enfin tout se brise…
Kattle était restée songeuse. A côté du chêne séculaire rendu ombrageux par le déclin du jour, qu’elle paraissait frêle et sans défense cette petite famille dont l’une des mailles n’allait pas tarder à se rompre ! Une semaine après la promenade dans le parc de la Roseraie, François Meyer quittait le monde des humains. Privée de la paye de contremaître-tonnelier de son mari, Liesel s’enfuit d’Alsace après maints déboires, et décida de s’installer dans la maison héritée de l’oncle jurassien.
Distraite par le souvenir de son enfance, Kattle atteignait machinalement la dernière ferme du village, lorsqu’un Allemand qui sortait, avec sous le bras un énorme jambon fumé au genièvre, s’avança sur elle d’une démarche incertaine. A un pas de la fillette, l’homme casqué sourit et ses lèvres tendues découvrirent de terribles dents blanches. Son haleine brûlait d’eau de vie de prune. Quand il vit Kattle si misérable avec sa couverture trouée sur les épaules, et cette sorte de poupée informe blottie dans ses bras, il éclata d’un rire goguenard et s’écria en se tapant sur le ventre :
- Malerans : bons Français !... Patriotes !
Et il s’éloigna à grandes enjambées dans la neige épaisse qui crissait sous ses bottes.
Remise de sa peur, Kattle courut bien vite en direction de la forêt. Dans les champs, les piquets des clôtures, noirs sur fond blanc, rappelaient les bâtonnets d’écoliers. Les corbeaux rasaient le sol recouvert depuis un mois de la même couche de neige durcie, et leurs appels suppliaient le cruel hiver. Les saules semblaient se déformer sous les tortures du froid.
A l’orée de la Malnoue, Kattle rencontra un vieil homme qui coupait du bois. Il avait allumé un feu et brûlait des branches. Sa silhouette déformée par la chaleur du brasier, tremblait et apparaissait au travers d’une fumée bleue.
- Approche te chauffer petiote ! lui cria le bûcheron.
Kattle avança, timidement. Arrivée près de lui, elle s’aperçut qu’il était chaussé de sabots garnis de paille, et qu’une peau
de mouton mal taillée découvrait une ceinture de flanelle débordant de son pantalon. Le vieil homme lui demanda :
- Que viens-tu faire dans la forêt ?
La petite répondit en rejetant ses nattes en arrière d’un revers de main leste :
- Je cherche du bois mort. Mutty a froid, elle est très malade…
Le vieux caressa sa moustache roussie d’un geste familier et questionna :
- Mouti ? Qui c’est ?
Mise en confiance par ce grand-père qui avait l’air bon, Kattle avoua :
- « mutty », en allemand, ça veut dire « maman »…
Le bûcheron se rembruni et cessa d’aviver son feu :
- T’es une gosse de Fridolins ? J’aurais dû m’en douter à ton accent.
Il sortit sa fourche du brasier, la brandit entre lui et la fillette et cria :
- Alors voilà que les Fritz nous envoient leurs chiards pour nous espionner ! Qu’est-ce que tu lui veux au grand Frédéric ? Tu viens compter ses stères de bois ! Fous-moi l’camp !
La petite se mit à pleurer :
- Je ne suis pas allemande, monsieur. Je dis « mutty » parce qu’en alsacien « maman » se dit « mome » ; alors si j’ai le malheur de dire « mome », tout le monde se moque de moi…
L’homme reposa sa fourche. Perplexe, il souleva son béret rivé à son crâne tant il en épousait la forme ronde.
- Ah ! Bon, t’es alsacienne… Mais pourquoi tu l’appelles pas « maman » ta mère ?
Kattle refoula ses larmes et dit :
- Tous les gens appellent mutty « la Boche ». A moi ils disent « catin » au lieu de Kattle ou de Catherine. Je ne peux plus aller à l’école, on me battait pendant les récréations et on déchirait mes pauvres habits. Mutty passait une partie de ses nuits à me les raccommoder… Aussi à la maison ne parle-t-on jamais le français…
Le grand Frédéric n’en revenait pas.
- Bin çà ! Nous à Enevans, on n’a rien contre les Alsaciens. C’est des gens qui trinquent comme nous. Comprends pas !
Puis, après un temps :
- Ah ! Au fait, où est-ce que tu habites ?
- A Malerans, fit Kattle.
L’homme leva les bras au ciel :
- Ça m’étonne pas ! « Gens d’Mal’rans ; gens de ren » (Gens de rien). On dit ça dans le canton et on n’a pas tout à fait tort. Remarque ; les gens de la région, faut les connaître. C’est pas du jour au lendemain qu’on est adopté. J’en sais quelque chose ; ma femme est d’ici mais moi je suis de Petit-Noir, près de la Bresse, de « P’tiot Nouère » en patois du coin.
Le vieux bûcheron, égayé par le souvenir de son village natal, ajouta :
- « Gens d’la plaine : bonne graine ! »
Puis il se remit à gratter son feu qui cuisait les visages et fumait les vêtements. Avec l’air de réfléchir en force il murmura :
- Ta mère est malade et vous n’avez pas de bois…
Kattle essuya une dernière larme et dit :
- On a des planches pourries. Un peu de fagot m’aiderait à les faire brûler… Bien sûr, avec de l’argent, je saurais bien où en trouver du bois… Mais mutty n’a plus de travail depuis la guerre, personne n’en veut à cause de son accent.
Gêné, le grand Frédéric toussota :
- Bon, écoute ! Du bois mort, j’en ai pas. Celui-là, il est vert et tout gelé. Dans la forêt, avec la neige, t’en trouveras jamais. Alors va jusqu’à Saint-Cyprien, c’est à la sortie de la Malnoue, tu iras au Café Bannelier et tu diras à la Madeleine que tu viens de la part du grand Frédéric d’Enevans, et du bois mort, t’en auras !
La petite remercia. L’homme remarqua le pantin qu’elle serrait contre sa
poitrine :
- Il est beau ton nounours !...
- C’est pas un ours, monsieur, c’est ma poupée : elle s’appelle Cosette !
Elle adressa un signe de la main au vieux bûcheron, et partit en sautillant sur la laie d’exploitation encroûtée de neige brunie.
- Pauvre gosse ! Murmura le vieillard.
Il empoigna sa hache et entreprit d’ébrancher un bouleau. Au bout d’un quart d’heure, il releva la tête, laissa tomber son outil et se mit à jurer !
- Quel couillon !
Il s’élança sur les pas de la petite en criant :
- Catherine, Catherine, reviens ! N’y va pas !
Trop tard ! Silhouette floue, la fillette s’évanouissait dans le lointain. Le grand Frédéric agita son béret en vain, puis il le pétrit entre ses mains gercées. Une larme roula sur sa joue fripée. Il soupira :
- Faut pas y aller ma pauv’gosse !... Faut surtout pas y’aller !
****
La neige pesait sur les branches des arbres et leur donnait un relief inhabituel. Les taillis semblaient de verre. L’air devenait plus vif et Kattle se mit à trotter, esquissant – ballerine de l’hiver – quelques pas de danse menue sur ce tapis blanc qui geignait sous ses pas. La route de la Malnoue, toute droite et maculée çà et là par les traces d’un gibier, était creusée de deux sillons imprimés par les roues d’une automobile. Au bout d’une demi-heure, la petite trouva décidément le chemin bien long. Et lorsqu’elle déboucha de la forêt, le coucher du soleil rougissait déjà la houppe des chênes et transformait les prairies en une véritable terre de feu. Eblouie, elle franchit le dernier virage, juste avant l’entrée de Saint-Cyprien, et buta soudain contre une sorte de poteau de garde-barrière qui barrait la départementale. Un aboiement la fit tressaillir : la ligne de Démarcation !...
Tiré par un gros Saint-Bernard, un Allemand sortit de derrière les fourrés et interpela Kattle :
- Ausweiss ? (Laissez-passer ?)
Tout naturellement elle répondit en alsacien :
- Nin, ich hob net! (Non, je n’en ai pas !)
L’Allemand portait des jumelles en bandoulière. Il leva le bras comme s’il allait gifler la petite et grommela :
- Ach! Französicher Kopf ! (Ah : Tête de Français !)
Et il la fit passer sous la barrière et la poussa de son revolver en direction du poste de police.
Kattle, secouée de tremblements, se souvint d’une histoire racontée par certains villageois : des soldats ivres avaient abattu un jeune garçon qui voulait traverser la ligne de démarcation au pont du Dombief.
Le poste de police était désert. L’Allemand cria quelque chose. Kattle attendit longtemps. L’obscurité tombait déjà lorsque le soldat revint avec le chef de poste. La neige se retrouvait bleuie par la nuit. Une pleine lune émergeait des grands bois et les tôles de la guérite luisaient sous sa pâleur métallique. Soudain, une Juva 4 surgit du virage et vint s’arrêter net devant Kattle. Raidie de peur, la pauvre gosse n’osait quitter le champ des phares de la voiture. Un officier en descendit et s’écria :
- Mein Gott! Anneliese! (Mon Dieu ! Anne-lise)
Kattle serrait très fort sur son cœur sa poupée de misère. L’officier passa une main sur ses yeux et se ressaisi. Il se tourna vers l’adjudant du poste de police qui grogna d’un air mauvais :
- Französicher Kopf!
L’officier lui jeta un signe d’impatience pour le chasser et s’approcha de Kattle.
- Comment t’appelles-tu, petite ?
Il avait dit cela sans le moindre accent et avec beaucoup de douceur.
- Je suis Kattle Meyer, de Malerans !
- Ah ! Catherine, poursuivit l’officier, tu ressembles tant à ma fille Anneliese qu’un moment j’ai cru…
Une violente émotion lui coupa la parole. Après un temps, il se reprit :
- Viens, ne restons pas ici, vraiment il commence à faire froid !
Sous le regard morne du gros Feldwebel (adjudant), il entraîna la petite en direction du village, tout en lui expliquant qu’il était le capitaine Folster, attaché à la Kommandantur de Malerans. Son excellente prononciation venait de ce qu’il enseignait le français à Mannheim. Ils entrèrent au café Bannelier. Dans un coin du bistrot, un petit vieux sec, vêtu de noir, essayait vainement de rouler une cigarette. Ses doigts noueux tremblaient et des grains de tabac tombaient sur la table de bois blanchi par l’eau de Javel. Au fond, étendu sur un banc, un autre client ronflait. Saucissonnée dans un tablier à carreaux
bleus, la patronne approcha en se dandinant un peu à la manière d’un canard de barbarie. L’officier commanda une bière pour lui et un petit verre de vin chaud pour Kattle. Ils trinquèrent. Le capitaine Folster semblait très jeune et ses grands yeux qui paraissaient fixés sur un autre univers lui donnaient le regard énigmatique d’un poète visionnaire. Il dit :
- Vois-tu Kattle, j’aime ce village de Saint-Cyprien. Chaque fois que je le peux, je m’échappe de la kommandantur de Malerans et je viens me réfugier là. J’ai toujours souhaité visiter la France… Il a fallu la guerre pour accomplir ce projet…
Il but une gorgée de bière, fit la grimace et dit, pour dérider Kattle :
- Il y a malheureusement, en France, une chose à laquelle je ne m’habituerai jamais : c’est la bière !...
Kattle devint pensive. Elle revit son père attablé au Bœuf Rouge de Schiltigheim, devant un seidel, ce pot de terre muni d’une anse et qui parfois – lors de beuveries mouvementées – devenait une redoutable arme de combat. Le capitaine Folster reprit, amer :
- Quand j’étais adolescent, mon père désirait pour moi une bonne guerre qui me ferait du bien, paraît-il. Ses vœux seront exaucés le jour où je recevrai une balle dans la peau !...
Dans le fond du bistrot, le petit vieux, enfin parvenu à coller le papier de sa cigarette difforme, l’alluma d’une main tremblante.
Tout à coup une voix éraillée commanda :
- Bordel de bordel, eh ! Madeleine : une chopine !
Le client qui dormait sur le banc venait de se réveiller, les yeux injectés de sang et la bouche tordue. Il lui manquait deux dents sur le devant. Kattle le reconnut. Elle l’avait rencontré un soir, ivre mort au pied de la fontaine de Malerans. Toute ronde, un peu essoufflée et les joues en feu, la patronne s’essuya les mains dans son tablier, saisit un entonnoir rougi par le vin et lui servit une chopine.
- Toi, c’est pas Broquin qu’on aurait dû t’appeler, c’est Broquet. Tu m’en as vidé huit depuis ce matin ! Faudrait voir songer à me payer ! Allez, ça fait quat’ francs !
Le client grogna, sortit de sa poche une poignée de monnaie :
- Tiens ! Paye-te Mais tu pourrais dire quatre-vingts sous au lieu de quat’francs : ça paraîtrait moins cher !...
Kattle acheva son vin chaud et se hasarda :
- Madame Bannelier, s’il vous plaît, pourriez-vous me donner un peu de bois mort ? Mutty…enfin, je veux dire maman…est malade et nous n’avons plus de feu. C’est monsieur Frédéric qui m’envoie…
Incrédule, la Madeleine demanda :
- Le grand Frédéric d’Enevans ?
- Oui, fit Kattle.
La Madeleine disparut aussitôt dans sa cuisine et en ressortit avec un petit fagot serré. Soudain on entendit crier dehors :
- Herr Hauptmann !...Herr Hauptmann ! (Capitaine !)
Les bruits de bottes se rapprochèrent et le gros adjudant entra précipitamment dans le café. Il cria quelque chose. Le capitaine se leva, soucieux, et dit à Kattle :
- Un train de permissionnaires vient de dérailler à Dombief. On me réclame à la Kommandantur. Bonne chance Catherine !
Puis, s’adressant à la patronne :
- Prenez soin de la petite, madame Bannelier !
Il sortit. Broquin se mit à grogner :
- Celui-là, il est autant fait pour porter l’uniforme que moi la barrette de curé !
- D’accord, répondit la Madeleine, mais c’est pas une charogne comme ce gourot (cochon) de Feldmachin !
- Le juteux ? (adjudant en argot militaire).
- Oui, Schwein ; ça veut dire «cochon , je crois…
- Et bin ! S’exclama Broquin, l’état-civil l’a soigné, c’te raclure !
La patronne avisa la pendule :
- Bon, dis donc, Broquin, il est déjà sept heures, je dois fermer. Ramène la gosse avant le couvre-feu ! Elle a pas l’air bien lourde cette petiote, elle chargera pas beaucoup ton vélo…
Broquin fit la grimace.
-…elle est envoyée par le grand Frédéric d’Enevans, alors tâche qu’elle arrive à Malerans, sinon tu remettras plus les pieds ici !
La Madeleine Bannelier referma la porte sur eux.
****
Un froid coupant leur sauta au visage et leur fit serrer les épaules. Avec la complicité du silence nocturne, les morsures de l’hiver paraissaient plus sournoises. Seule, une odeur de fumée de bois, une de ces bonnes odeurs de fumée de bois qui vous réchauffent les souvenirs du cœur, témoignait qu’entre les murs des chaumières calfeutrées, la vie palpitait toujours. Un peu dégrisé, Broquin grommela :
- C’est pas l’tout, mais qu’est-ce qu’on va en foutre de ton fagot ?
La petite proposa :
- Madame Bannelier l’a noué avec une grande ficelle, attachez-la après le porte-bagages ; le fagot pourra glisser comme un traîneau sur le chemin gelé !
- Comme un traîneau…comme un traîneau… C’est pas toi qui vas pédaler, la môme ! Et puis eh ! Faudrait voir à pas me donner des ordres !
Ils partirent. La lune projetait sur la neige bleuie la silhouette des arbres qu’elle transformait en marionnettes de l’Au-delà. Des ombres biscornues, tapies sur la route, semblaient vouloir entraver la progression du vélo qui dérapa dans un virage. Broquin parvint juste à rétablir l’équilibre.
-Putain ! On va se casser la gueule avec ton attelage !
L’homme freina et le cycle s’arrêta en chassant sur la glace avec un chuintement.
- Descend ! Cria-t-il à la fillette.
Kattle obéit. Broquin saisit son couteau, coupa la ficelle du fagot dont il jeta les deux tiers sur le talus. Kattle essaya de protester :
- Mais…
- Boucle-la, y t’en restera toujours pour allumer ton feu !
Ils repartirent.
La dynamo du vélo ronronnait, irrégulière. Entre deux coups de pédale mal assurés, Broquin souffla :
- Ca fait rien, va pas faire chaud c’te nuit, voilà qu’la bise se lève.
Seulement vêtue d’une petite jupe et de chaussettes trop grandes qui lui tombaient dans les souliers, Kattle sentait ses jambes se glacer. Elle serra sa couverture sur les épaules, après y avoir dissimulé sa poupée de misère et murmura tout bas :
- On va avoir froid, Cosette !
Au bout d’un bon kilomètre, comme Broquin se dirigeait sur Enevans, Kattle demanda, surprise :
- Mais monsieur, on ne passe pas par là pour aller à Malerans !
L’homme répliqua :
- Oui, je sais. On va faire un détour par Villers-du-Bois. J’ai envie d’aller boire la goutte chez l’Maxime !
Kattle désolée s’inquiéta :
- Alors quand va-t-on rentrer ?
- Ça, tu l’verras bien, gamine !
- Mais mutty a froid…
- Ta mouti, elle a rien qu’à demander au voisin d’la réchauffer, eh ! Pardi !
Satisfait de sa plaisanterie, Broquin se tapa sur la cuisse en rigolant. Le vélo fit une embardée et roula au fond d’un grand fossé. Ils pataugèrent dans la glace, dans l’eau et dans les ronciers qui leur agrippaient les jambes. Enfin parvenu à hisser le cycle sur la route, Broquin s’aperçut que son guidon était tordu.
- Vérole de gaille : une bécane de huit cent francs ! En plus je suis complètement gaujé (être « gaujé » : avoir de l’eau dans ses souliers).
- Moi aussi je suis toute mouillée et j’ai perdu ma poupée !...
L’homme rendu mauvais par le vin qui lui remontait hurla :
- M’emmerde pas avec ton tas de chiffons !
Puis, d’une bourrade, il renvoya la petite au fond du fossé :
- Va la retrouver ta poupée, moucheron ! Moi, j’ai assez perdu de temps avec toi !
L’ivrogne enfourcha son vélo et s’enfuit avec le restant du fagot de bois qui balayait la neige derrière lui.
****
Lorsque Kattle ressortit du fossé, les jambes toutes griffées, le vélo n’était plus qu’un petit point de feu rouge qui s’éloignait dans la nuit en vacillant. Les yeux embués de larmes, elle repartit en serrant très fort sur son cœur sa poupée alourdie par l’eau glacée. La bise sifflait dans les houppes décharnées, serpentant preste entre les troncs, pénétrant les taillis, heurtant finalement la route de son haleine gelée et coupante, entraînant derrière elle des brindilles qui filaient au ras de la neige durcie. La forêt toute entière haletait, gémissait aussi, lorsque deux branches entrelacées grinçaient sous la tourmente des vents. Par intermittence, un cri plaintif retentissait, lointain, déformé. Kattle pensa soudain à l’oiseau qui pleure les morts. Quand souffle la tempête d’hiver, on entend dans les bois l’appel funèbre du « pleureur ». Sa plainte invite le passant à prier pour les âmes des Trépassés.
Kattle reprit sa route. Il faisait décidément très froid. Ses chaussures et sa robe commençaient à durcir par endroits. Ses mains, ses jambes, engourdies et violacées, semblaient se solidifier au point qu’elle redouta de tomber. Enfin, elle aperçut les silhouettes noires des toits des maisons se découpant sur le ciel piqueté d’étoiles. La lune éclairait une pancarte. Elle s’en approcha et lu : « Villers-du-Bois ». Elle pensa au terrible Broquin qui s’y était rendu pour boire la goutte chez un copain. Elle frapperait bien à une chaumière pour entrer se réchauffer, mais si elle se retrouvait nez-à-nez avec l’ivrogne ? Lasse de fatigue et de gelures, elle osa pénétrer dans une cour de ferme. Ses pas effleurèrent puis écrasèrent la neige intacte de traces, d’où s’évanouirent des crissements d’ouate comprimée. Plantée dans le tas de fumier, un manche de fourche luisait, en projetant une ombre démesurée sur le sol brillant de glace.
Elle se dirigea vers la grange et entrouvrit le vantail qui jeta un cri de bête. Un triangle de lumière du ciel se faufila par l’entrebâillement et se découpa sur le sol de terre battue. La porte de l’étable devait être ouverte car une chaleur alourdie d’odeurs bovines épaississait l’air. Sur un petit tas de paille, elle distingua une forme qui remua, se leva, puis s’en vint près d’elle d’une marche irrégulière. C’était un chien. Vieux, poussif, il fit un « wouf » à peine audible. Kattle se baissa pour le caresser et s’aperçu qu’il portait un énorme pansement à une patte de devant. Elle le suivit sur sa litière. Le chien se lova contre elle en poussant des grognements plaintifs. Ce devait être un cocker, Kattle sentit ses grandes oreilles tombantes quand elle flatta sa grosse tête bosselée. Elle demanda :
- Comment t’appelles-tu : Néro ?
Le chien ne broncha pas.
- Fléckel ?... Mirzel ?...
Puis elle s’écria :
- Je suis bête ! On n’est pas en Alsace…
Elle poursuivit :
- Mireau ?... Pateau ?... Azor ?...
Le chien avait frémi. Elle reprit :
- Azor ?...
Cette fois-ci, le vieux cocker remua la queue avec un petit coup de gueule retenu. Heureuse, Kattle répéta :
- Azor, mon chien de la nuit !
Elle se serra contre lui après avoir étendu Cosette près de son flanc, et vécut l’un de ces moments de rien où les pauvres gens cessent d’être malheureux, même si la joie donnée sur terre ne leur vient que d’une bête. Au bout d’un instant, elle entendit comme un bruit de râpe : c’était le vieil Azor qui léchait la poupée à demi-gelée… Puis elle s’endormit.
****
Il était dix heures du matin lorsque lebûchron de la ferme des Rieux traversait la forêt de l’Argançon. A l’entrée de la sommière des Maréchaux, il aperçut un attelage de deux chevaux noirs dont les naseaux soufflaient des écharpes de buée. A côté de ses bêtes, un homme allait d’un drôle de pas, avec des gestes et des airs tour à tour menaçants et réjouis. Le bûcheron reconnut le commis des Bannelier. Il le héla :
- Alors, Gustave, t’as vu l’temps ? Moins seize à huit heures !
L’autre ne répondit pas tout de suite. Parvenu à sa hauteur il insista :
- Eh bien ! Qu’est-ce que t’en fais des singeries !
L’homme dit après un petit rire malicieux :
- Regarde dans la charrette !
Le bûcheron souleva la bâche et il découvrit Broquin, tout sec et tout jaune comme un hareng-saur.
Le commis des Bannelier expliqua :
- Je viens d’ le trouver au bord de la route, étendu par terre sur son vélo, juste au bout de la cour du Maxime à Villers-du-Bois.
- Au fait, il est mort ? Demanda le bûcheron.
- Peut-être pas mais ça n’a pas d’importance. Je le mène au Café de mes patrons. On avisera là-bas ! Mais écoute voir plutôt ce que j’ai à te raconter !
Et les deux hommes repartirent côte à côte dans un soleil, ma foi, prometteur. Le commis raconta :
- Donc, cette nuit, vers dix heures, voilà mon Broquin qui arrive chez l’ Maxime et qui tape à la porte jusqu’à ce qu’on lui ouvre. Tu sais que l’Maxime, c’est un vieux garçon grognon qui n’aime pas du tout qu’on l’ dérange ; pour le voir il vaut mieux prendre un rendez-vous. Il ouvre quand même à Broquin, lui sert tout de suite la goutte pour s’en débarrasser plus vite. Et puis, comme il était levé, autant que cela serve à quelque chose d’utile ; il pense alors juste à son chien qui est malade d’une patte et qui dort dans la grange juste à côté de l’étable… Or, avec son chien, il trouve une petite fille endormie… Il la réveille doucement, l’emmène à la cuisine. Mais lorsqu’elle se trouve nez–à-nez avec Broquin, elle se met à pleurer, le montre du doigt en disant : ‘c’est lui qui m’a jetée dans le fossé plein d’eau glacée !’ Comme tu penses, le Broquin n’avait pas demandé son reste pour se barrer dès qu’il avait senti que les choses tournaient plutôt mal pour lui. Il est donc parti comme un voleur, s’est cassé la gueule en vélo, juste en sortant de chez l’Maxime, ne s’est pas relevé et c’est moi qui l’ai ramassé ce matin en passant par là…
Le bûcheron des Rieux demanda :
- Et la petite fille ?
Le commis des Bannelier, mis en joie par cette histoire qui finissait bien, termina :
La petite Alsacienne – à qui d’ailleurs ma patronne avait donné la veille un petit fagot de bois pour sa mère – a tout raconté au Maxime qui est allé, ça c’est un miracle, chercher son cheval Pompon, l’a attelé, a chargé du bois bien sec, et emmitouflé confortablement Kattle pour la reconduire chez sa mère à Malerans. Avec un clair de lune carabiné, le voyage a été rapide. Et tant pis pour le couvre-feu ! Le Maxime, finalement, n’est revenu de chez Liesel Meyer que vers sept heures ce matin, après s’être entendu copieusement avec elle pour qu’elle vienne tenir son ménage de temps en temps… Pour commencer ! Egalement, il paraît que Kattle a dit vouloir faire la rééducation du chien Azor…
Puis il conclut :
- Allez, c’est la Saint Nicolas pour les Alsaciens, viens chez la patronne qu’on fête tout ça !
Et le bûcheron des Rieux ajouta :
- D’accord, on va vider deux ou trois broquets sur le compte et à la santé de Broquin… S’il est pas mort !
La première version de cette nouvelle, intitulée « Le Bois mort » est parue :
- en 1978 dans une anthologie des auteurs du Pays comtois Ed. REPP (Lure, Haute-Saône) ;
- en 1984 dans l’Almanach Le Grand Messager Boiteux de Strasbourg.
___________
VERS CINQ HEURES À CHANECEY
Il faisait nuit. Depuis sa chambre, Pauline fixait la lumière jaune de la dernière fenêtre à gauche, dans la maison d’à côté, au deuxième étage, à mi-hauteur du sapin dont les branches balayaient les vitres sous les bourrasques du vent. Libérées de l’entrave des bergères usées par la rouilles, deux persiennes du rez-de-chaussée claquaient si violemment qu’elles abrégeaient la plainte de leurs gonds. Une pluie furieuse s’abattait dans la cour et s’écoulait entre les pavés en un gargouillis sans fin. Les coups des dix heures sonnaient, lointains, dispersés. Comme chaque soir, la jeune fille restait plantée au milieu de sa mansarde, engourdie de fatigue, vidée de toute personnalité, sans la moindre volonté contre cette langueur qui depuis des semaines la rabaissait au niveau d’un pantin prompt à exécuter des ordres.
La dernière fenêtre à gauche... Elle l’imaginait, lui, parmi ses livres, la tête agacée par une mèche blonde sans cesse rejetée d’un revers de main. Les cigarettes se succèderaient selon l’âpreté de l’étude, et demain matin encore il y aurait un plein cendrier de filtres à vider... Pour un futur médecin, ce n’était guère raisonnable de fumer ainsi. Malgré sa mélancolie, Pauline sourit. Elle inventait déjà les histoires qu’elle se raconterait avant de s’endormir ; elle lui dirait par exemple : « ne fume pas trop ! ». Oui, elle le tutoierait, il ne s’en offusquerait pas, il lui concèderait de sa voix posée toujours soucieuse de plaire : « D’accord, mais c’est bien pour te faire plaisir ! ». Il déposerait peut-être un baiser sur sa joue en disant : « Pauline, tu es une bonne fille, reste un moment près de moi si tu veux, mais ne fais pas de bruit ; j’ai un cours d’anatomie très difficile à repasser ! »
Chaque soir, line peuplait ses rêves éveillés d’histoires d’amour sans dénouement, de ces histoires que l’on aime à se raconter, en les ressassant, image par image ; de ces chimères si sublimes que le sommeil en reprend parfois le thème et tout semble devenir réalité. Avec des gestes languides elle commença à se dévêtir. Cette sentimentalité la mènerait à quoi ? Au bonheur ?... Les cœurs sensibles sont rarement heureux. Son cœur, elle le sentait gros et combien fragile ! Devant la glace de l’armoire, elle le voyait battre et agiter son sein de petites secousses. Pauvre cœur pas gâté de tendresse, méconnu, inutile comme une horloge dans une maison vide... Et cette bouche amère peu encline aux sourires ; ces lèvres souvent pâles dans lesquelles personne n’avait jamais mordu : ce nez empâté et ces yeux sombres toujours en quête d’un regard profond : pourraient-ils un jour émouvoir un garçon ? Les cheveux noirs marquaient un bon point. Pour la poitrine, la taille et les jambes : pas de soucis à se faire ! Il lui suffisait de se remémorer ces soirées de bal passées à déjouer les manœuvres des mâles au sexe de chien, avides d’une viande à jouissance. Avec l’époque de la mini-jupe il aurait fallu acquiescer à la demande de coucheries express ! Triste Pauline, tu pouvais les raviver tes désirs de communication avec celui qui aurait enfin compris ta solitude ; des mains sur tes cuisses, d’accord ; mais de la bonne amitié qui ne demande rien en retour, là non : il ne faut tout de même pas rêver ! Pourquoi les êtres attirants avec lesquels il ferait bon suivre un bout de chemin demeurent-ils obstinément dans l’ombre ? A la croisée des routes la maldonne se gausse des affinités et l’on voit s’évanouir l’espoir de connaissances électives ; et l’on sait qu’il faudra supporter le coudoiement impudique de mille de nos semblables qui nous indifférent ; et l’on affectera d’apprécier la familiarité des fâcheux dont notre existence dépend ; tout en pâtissant de la leur... Combien de sympathies soudaines, d’amitiés opportunes, de faux épanchements pour une seule coudée franche ?
Au deuxième étage, la lumière de la seconde fenêtre à gauche s’éteignit.
- Olivier !
****
Pauline revit son arrivée au « Château », un grand pavillon de cinquante fenêtres ; la Fromagerie, une bâtisse ancienne perpendiculaire aux appartements et dans laquelle elle occupait une chambre de bonne ; enfin le patron, un grand vieillard tout gris osseux qui toisait le monde d’un regard dur ; et les deux fils. L’aîné aidait le père, le plus jeune étudiait la Médecine. Nantie de son CAP d’aide-ménagère, Pauline avait quitté Lons-le-Saunier pour venir s’occuper des cinq enfants en bas âge. Retranchée dans ses activités paroissiales, la bru montrait fort peu d’empressement au service domestique, et à dix-huit ans, la jeune fille se retrouvait quasiment mère de famille. Pas question de compter sur un rayon de bonne humeur ou de gaieté ; les Cloport étaient partis de rien, et comme tous les parvenus soignaient farouchement leur maintien de petits hobereaux avides de considération. Pauline mangeait avec les enfants. Elle servait ensuite les maîtres dans la grande salle Henri II, avec son tablier blanc noué dans le dos. Nul ne paraissait remarquer sa présence. Après avoir grommelé le Bénédicité comme s’il était contraint de rendre des comptes à Dieu, le vieux Cloport lâchait un grognement à son adresse et elle accourait avec le premier plat. La mère obèse et le fils aîné bâfraient en vidant de pleins verres de rosé. La bru chipotait par souci de sa ligne modifiée par les grossesses. Malheur si un mets venait à irriter les palais !
-Pauline, c’est ainsi que vous avez appris à préparer le hachis Parmentier ? Espèce d’œuf ! Tout dans le corsage mais rien dans la tête !
À la moindre remarque sur les rondeurs de la bonne, le fils aîné levait son gros nez de son assiette et passait une langue émoustillée sur ses lèvres. Ah ! Celui-là, s’il pouvait la coincer dans la cave d’affinage ! Par prudence, Pauline s’habillait sobrement, préférant le pantalon à la jupe et la blouse au gilet trop moulant.
Le Dimanche, elle restait au village. Où aller ? Chez elle ? Où était-il son chez soi ? Certainement pas auprès de cette tante qui l’avait recueillie à la mort accidentelle de ses parents, et contrainte à préparer un CAP quelconque au lieu de lui accorder l’école de décoration. Mais cette nièce douée pour composer des bouquets de fleurs, pour disposer des meubles, transformer une pièce ; cela l’importunait. Elle la traita de prétentieuse et la jeta chez les Sœurs.
-Regardez-la, ça veut réussir alors que moi qui la fais vivre j’ai trimé des années ! Un peu de vache enragée te fera du bien, je suis passée par-là ; tu y passeras aussi !
En regardant vivre les autres, Pauline découvrit qu’un être pouvait s’astreindre à une existence insipide, voire révoltante, seulement motivé par la certitude de vivre en conformité avec un ensemble de principes religieux et autres. Qu’une aveugle obstination pût tenir lieu de mérite lui paraissait suspecte. Elle ne voulait pas subir de résignation par force ; jamais elle ne deviendrait cette tante bigote qui allait chaque semaine se faire pleurer au cinéma sur des destinés fictives, mais qui aurait crevé de jalousie de voir sa nièce choisir une situation. Pauline était loin de pouvoir analyser le comportement de tant de ses semblables et d’en saisir les failles et les hypocrisies. Un jour sans doute elle comprendrait que la charité n’est souvent rien d’autre que l’intérêt personnel dissimulé sous le masque de l’altruisme ; que l’égoïsme le plus raffiné consiste à faire quelque chose pour éviter un sentiment désagréable ; que la religion qui croit rendre les gens meilleurs les rend parfois plus mauvais et plus malheureux... Elle deviendrait un jour éveillée, apprendrait à vivre avec conscience malgré la multitude des morts-vivants qui dorment en se posant parfois la question de savoir s’il y a une vie après la mort, mais qui ne se soucient jamais de l’essentiel – à savoir s’il y a une vie avant la mort !
Ses heures de temps libre, Pauline les passait étendue sur son lit étroit, dans un état d’hébétude, jusqu’à ce que le sommeil vînt la soustraire à ce mal intentionnellement avivé :
-Tu n’es qu’une ratée, tu aurais dû résister, lutter, quitte à en rabattre avec ta pudeur. Une fille peut toujours se débrouiller ; la nature l’a dotée d’arguments palpables dont elle serait bien idiote de ne pas tirer parti. Maintenant tu es bien avancée ! Va donc torcher les chiards des parvenus ! Ah ! La gueuserie n’est pas morte.
Le plus dur à supporter demeurait cette familiarité de patron à domestique. Elle disait « bonjour Madame ! », on lui répondait : « salut ! » et on la tutoyait sans balancer. Les gommeuses avaient de la chance, elles, avec leurs belles voitures et leur petit air supérieur ! Elles, on les saluait poliment ; elles, on les vouvoyait. A elles la considération : à la boniche le mépris et la vulgarité !
Tout lui rappelait son insignifiance. Même cet amour né de simples regards. Olivier, le fils cadet, était le seul de la maison à répondre à son salut, et à poser quelquefois les yeux sur elle ; des yeux bleus, calmes, d’une sérénité qui jurait avec le maniérisme familial. Il venait chaque fin de semaine à la Fromagerie et Pauline le voyait à table. Ces jours-là, elle prenait grand soin de sa mise ; rehaussait ses paupières de mauve et laissait flotter de son corsage entrouvert un léger parfum de verveine. Lors d’un souper, alors qu’elle se penchait pour servir, elle sentit le regard du jeune homme se poser sur la naissance de ses seins. Ce petit braconnage d’intimité, loin de la gêner, lui rendit tant de confiance en elle qu’elle ne pût réprimer un sourire. Olivier s’en aperçut. Leurs regards se croisèrent avec insistance. Elle crut entrevoir dans le sien de la vraie tendresse.
****
Pour Pauline, les jours de la semaine devinrent de longues épreuves de patience et d’angoisse, qui cessaient lorsque la Volkswagen franchissait le portail de la Fromagerie dans un crissement de gravillons. Elle était rassurante cette petite voiture blanche qui faisait le gros dos. A sa vue, Pauline sentait son anxiété glisser tel un mauvais nuage. Olivier vivait quelque part dans la grande maison, et sa présence même lointaine lui suffisait.
Un lundi matin, comme elle entrait sans frapper dans son bureau, elle se trouva nez-à-nez avec lui. Elle s’arrêta sur le seuil, les bras ballants ; une moue d’enfant grondée sur les lèvres.
-Excusez-moi ! D’habitude...
-D’habite je ne suis pas là. Désolé de t’imposer ma présence, chère Pauline, mais aujourd’hui, j’ai décidé de prendre des vacances.
Pauline revivait. Enfin, elle se trouvait seule avec lui. Vêtu d’une veste de laine blanche, il fumait la pipe, en compulsant un énorme livre d’échantillons de papiers peints. Ses cheveux clairs ondulaient sur sa nuque et lui composaient une coiffure très jeune. Entre deux bouffées de fumée bleue qui exhalait un parfum de miel, il dévisageait la jeune fille debout devant lui, un peu naïve avec son allure de bonne toujours à l’affût d’un ordre.
-Ce matin, pas de balayage ; je refais mon bureau ! Regarde le papier que j’ai choisi !
Il lui montra une feuille crème fleurie d’acanthe lie de vin.
-Le plus délicat, c’est de trouver une peinture adéquate.
Pauline n’aurait jamais souhaité meilleure occasion de se mettre en valeur. Elle s’enhardit :
-Facile, au contraire ! La peinture doit être d’une teinte inférieure à la couleur de fond du papier, c’est l’abc de la décoration. Moi, je choisirais blanc cassé.
Le jeune homme parut étonné. Un instant il fronça les sourcils, puis un sourire détendit son visage :
-Mais Pauline, tu es douée ! D’accord pour le blanc cassé !
Le regard du jeune homme s’était rembruni. Il lui prit la main :
-Tu n’es peut-être pas à ta place dans cette maison avec ta pelle et ton balai ?
Pauline baissa les yeux, une envie de pleurer lui pinçait les lèvres. Il ajouta vivement :
-En tout cas, cette semaine, tu seras ma décoratrice !
Malgré les hauts cris de la bru qui n’admettait pas que son beau-frère portât un aussi grand intérêt à la bonne ; les deux jeunes gens passèrent six pleines journées à peindre, farfouiller dans les greniers, rameuter tous les objets prétendant à l’épithète de décoratif. Les feuilles d’acanthe lie de vin feutrèrent les murs d’auburn, un magnifique poêle en faïence blanche fut posté dans un coin, le bureau-ministre trôna au centre d’un parquet ciré à se rompre le col au moindre faux-pas. Une fois posés les rideaux striés de marron, restait l’horloge comtoise à mettre à l’heure et à remonter. Pauline grimpa sur une caisse et fit jour les aiguilles de cuivre.
-Olivier, quelle heure est-il ?
Au travers des carreaux, le couchant du soleil embrasait d’orange la neige des toits. Les ombres commençaient à se faufiler dans la pièce comme pour y reprendre –pèlerines de l’Au-Delà – leurs places nocturnes.
-Oh ! Olivier, que fais-tu ? Insista-t-elle sans se retourner.
Soudain, elle sentit deux mains entourer sa taille et une haleine chaude, affolée, tiédir doucement ses jambes le long de la jupe noire.
-Il est cinq heures, ma chérie, descends vite !
Ils se retrouvèrent dans les bras l’un de l’autre. Pauline, pâmée et les yeux brillants, balbutiait des mots incompréhensibles. Une bouche avide dévora ses lèvres.
****
La jeune fille vécut les jours suivants dans une euphorie et une distraction rabrouées par bien des remontrances. C’était le poisson servi froid comme la mort, la chambre des enfants dont la lumière restait allumée tard dans la nuit, le chat qui attendait vainement sa goutte de lait. Elle s’enhardissait même à soutenir le regard haineux de monsieur Cloport, au risque de s’attirer des grognements réprobateurs. Elle s’amusait à le voir remuer ses mâchoires démesurées ; il dévorait avec la hargne du dogue rongeant un os trop dur, elle aurait juré qu’au moindre geste brusque d’un tiers, il allait montrer des crocs luisants ou peut-être mordre, qui sait ? Un midi, cette pensée la fit pouffer sans retenue et on la pria de ne plus reparaître avant la fin du repas. Ravie de ce temps libre chapardé, elle courut s’enfermer dans la chambre d’Olivier. Il était retourné à la faculté. Elle feuilleta ses livres truffés de mots barbares et de photos inquiétantes : des êtres dépecés, disséqués, des ventres ouverts sur des masses viscérales. Dieu quelle mécanique compliquée que l’être humain ! Entre les pages de cet univers inconnu d’elle, elle inséra des signes parsemés de « je t’aime » et de petites marguerites. Elle connaissait la réaction d’Olivier :
- Tu m’empêches de travailler. Quand je trouve tes dessins, j’ai envie de tout laisser tomber et de courir t’embrasser...
Elle répondrait invariablement :
- Pourquoi ne le fais- tu pas ?
Alors on profiterait d’une absence de la bru pour réinventer une myriade de nouveaux baisers qui laisseraient essoufflés et chauds de désirs.
Le premier Dimanche de Janvier 1976, la famille Cloport quitta la Fromagerie en début d’après-midi. Prétextant un cours en retard, Olivier resta seul. Depuis sa mansarde, Pauline le vit sortir du garage la GS verte de son frère. La voiture décrivit dans la neige de longues courbes autour du parterre de rosiers, et vint s’arrêter au pied de la maison. Trois coups de klaxon retentirent. La jeune fille ouvrit la fenêtre.
- Pauline habille-toi, nous partons !
Elle jeta un manteau blanc sur ses épaules et dévala l’escalier. Dans la cour, Olivier, vêtu d’un anorak bleu l’embrassa avec passion.
- Si ton père nous voyait !
- Petite fille, allez, monte !
Pauline se calla sur le siège moelleux et la voiture quitta le village. La route, striée d’étroites bandes de verglas, se déroulait devant eux, se frayant un passage entre les deux pans de l’étroite vallée qui semblaient parfois se rejoindre. La GS quitta bientôt la Départementale et grimpa le long d’un sentier entre les sapins crépis de givre. A chaque virage, Chanecey s’enfonçait un peu plus dans le ravin, et lorsqu’ils arrivèrent au sommet de la montagne, vu depuis le belvédère du Chamois, le clocher de la petite église paraissait chétif avec ses maisons de poupées blotties autour. De temps à autre, Olivier rejetait d’un coup de tête la mèche rebelle qui lui balayait le front. Les deux jeunes gens n’avaient pas prononcé une seule parole. De simples regards mal assurés trahissaient leur émoi. Parvenus au centre de la clairière, Olivier arrêta la voiture et attira Pauline contre lui. Sans même y penser, elle déboutonna le haut de son manteau. Des doigts impatients éveillèrent sa poitrine au travers du gilet.
En contrebas, le village vivait sa bonne vie du Dimanche après-midi. Une fumée s’élevait par-ci par-là d’une cheminée retenant près de ses bûches crépitantes toute une famille attardée par le gâteau dominical.
Les seins de la jeune fille jaillirent soudain, roses et déjà durcis par les premiers attouchements. Olivier y enfouit son visage. Il ne connaissait rien de plus enivrant que ces deux globes de chair sensible d’où émane cet effluve de sève qui rend les filles si désirables. Non, jamais, dans nulle circonstance de la vie, il ne lui serait possible de toucher, oui de toucher, la tendresse ; une tendresse qui laissait bien à cour de mots pour la définir, la bénir, l’exalter ! Sans doute quelque subconscience poussait-elle l’homme à y rechercher la prime sécurité et le bonheur du sein maternel ? Contre la poitrine d’une femme, il faisait si bon écouter ce cœur palpiter un peu pour soi. Olivier poursuivit la conquête de ce corps docile. Pauline soufflait de petits mots tendres. Elle s’abandonna heureuse à la sensation nouvelle qui affolait son ventre et lui chavirait les yeux.
Pauline fut la première à quitter la chaleur de la voiture. La clairière barrée au loin par un rideau d’épicéas, s’étirait, aveuglante de neige et de glace. Le soleil jaunissait le Fort Saint-André agrippé au bord de la montagne d’en face. L’air vif aiguillonné d’une odeur de résine dissipait la somnolence des jeunes gens recrus d’amour. Olivier rompit le silence :
- Pauline, essaie de me cueillir un rameau de buis pour mettre dans ma chambre. J’en ai aperçu derrière le parapet ; moi j’ai le vertige !
Pauline enjamba la barrière verte. Un étroit sentier la séparait de l’abîme ; une paroi de rochers piquant une descente sur Chanecey, juste au-dessus de la maison du garde-chasse. On apercevait en bas une tache noire qui traversait la cour. Les aboiements du chien parvenaient à la jeune fille avec une intonation étrange. En hâte, elle tira une touffe de buis à demi-déracinée et regagna la terre ferme du belvédère.
Adossé au capot de la voiture, Olivier fumait, jetant la cendre de cigarette d’un claquement de doigts nerveux. Pauline se lova contre lui. Il eut un imperceptible mouvement de recul.
- Ce sera bien, nous deux, osa-t-elle.
Dans son regard, une expression de tendresse heureuse la rendit vraiment jolie. Le jeune homme fixait l’horizon. Des volutes de fumée bleue s’échappaient de ses narines. Quatre coups d’égrenèrent en bas dans le village. Le son de la cloche semblait vaciller et se fausser au fur et à mesure qu’il s’élevait de la vallée. Le Fort Saint-André cuivré par le couchant surgissait d’une légende.
-Comme dans les contes de fée s’enhardit-elle ; la petite bonne épousée par le beau docteur...
Olivier haussa les épaules :
-Pauline, quand cesseras-tu de rêver ? Et d’abord, qui t’a parlé de mariage ?
La jeune fille sentit battre ses tempes.
- Mais enfin, je croyais...
Le paysage chancela un instant devant ses yeux brouillés par les larmes.
- Justement, poursuivit-il, je voulais te dire... Demain, je quitte la Fromagerie. Je logerai à Besançon chez mes futurs beaux-parents.
En proie à un malaise, Pauline porta les mains à ses joues comme pour y raviver le sang.
Olivier adopta un ton plus conciliant :
- Si tu veux, nous pourrons rester ensemble toute la soirée ?
- A quoi bon, maintenant que tu as eu ce que tu voulais ?
- Mais enfin, Pauline, comprends-moi. Dans un an je serai médecin.
- Et moi je ne serai jamais rien. Pourtant, si j’avais eu des parents aisés comme les tiens, je ne serais pas en train de me prostituer chez les bourgeois...
Des pensées confuses s’entremêlaient soudain dans sa tête ; de pauvres répliques de fille désarmée.
- Tu as de la chance de pouvoir étudier, moi, le soir, lorsque je passe de longues minutes dans ma mansarde froide à regarder ta lumière, là-bas à la dernière fenêtre à gauche ; je pense que je pourrais être à ta place, bien douillette, dans un bureau bien éclairé. Tu sais : je ne suis pas idiote... Je croyais que tu m’aimais...
Pauline était devenue subitement pâle, le corps secoué de tremblements et les yeux brillants de fièvre. Les bouclettes de ses cheveux tressautaient sur le col de son manteau blanc.
Le jeune homme, lui, s’était réfugié dans la voiture. Un claquement de portière, puis, penaude, la GS verte fit demi-tour et disparut entre les sapins.
Restée seule, Pauline s’accouda au parapet du belvédère, les épaules secouées de sanglots et resta longtemps prostrée contre le dur métal rouillé. Le ciel devenait d’un gris brumeux et de minuscules flocons de neige très durs se mettaient à saupoudrer tout ce qu’ils atteignaient. Un chien aboya tout en bas du plus loin du village. A deux pas, la nuit frôlait déjà sans bruit les sapins de ses châles redoutés.
C’est alors que Pauline, se redressant comme une chose mécanique, enjamba le parapet. Elle glissa le long de l’étroit passage devant la haie de buis qui la séparait du vertigineux rocher s’ouvrant tout d’un coup béant à cinq cent mètres au-dessus du village. la solitude, la pauvreté, la servitude, un avenir banal de médiocrité... A quoi bon ?...
En bas, cinq heures sonnèrent du clocher fêlé de Chanecey.
Pauline lâcha la dure barre de fer et, très lentement, commençait à fermer les yeux...
****
- Mademoiselle Pauline !... Mademoiselle Pauline !...
À deux mains Pauline empoigna de nouveau le parapet, mais cette fois-ci avec un sentiment de curiosité, de soulagement et de délivrance qui d’un coup la dégrisa de sa tentative de mort. D’où venait cette voix ? Mais c’est vrai que maintenant il faisait presque nuit.
- Mademoiselle Pauline, Mademoiselle Pau...
Les projecteurs du belvédère du Chamois venaient de s’allumer et Pauline sursauta de voir surgir en face d’elle le curieux personnage qu’elle reconnut dans un sourire encore un peu désespéré. En 1944, les habitants de Chanecey échappèrent miraculeusement aux représailles de la Gestapo qui avait envisagé un temps une fusillade générale et la destruction du bourg. Aussi, après la Libération, firent-ils ériger une croix en fer forgé de douze mètres de haut sur le belvédère du Chamois. De judicieux projecteurs l’éclairaient la nuit depuis la Fromagerie blottie au bas de la montagne. Et, par une magie bienveillante, le visage du Père Gratien apparaissait, comme éclairé d’en bas, et lui donnait une barbe de lumière ainsi que des traits parcheminés de patriarche. Sans trop se rendre compte de ses mouvements, Pauline avait regagné la terre ferme du belvédère, et c’est avec une curiosité non dissimulée qu’elle tendit son visage vers l’étrange visiteur comme pour lui demander la solution. Le père Gratien n’avait pas bougé et jouissait, conscient, de l’effet de lumière qui soulignait le mystère bienveillant qui l’avait toujours enluminé. Cet orientaliste sans âge – certains lui donnaient plus de quatre-vingt- seize ans – avait publié depuis plus d’un demi-siècle des dizaines d’ouvrages sur l’Inde qu’il avait parcouru dans tous les sens. De sa voix profonde, lente et apaisante il commença :
- Eh bien ! Pauline, désirez-vous à votre histoire, banale, une conclusion de mauvais roman-photo ? Voulez-vous que l’on dise ou que l’on écrive un jour : « Ce soir-là, durant la veillée, peu de gens parmi les habitants de Chanecey purent trouver les mots pour ébaucher une conversation soutenue. Tous avaient encore, animé devant les yeux, le garde-chasse au visage ingrat, auquel une larme donnait un soupçon de beauté. Le vieil homme parlait sans fin de cette forme blanche qui, vers cinq heures à Chanecey, tombait silencieusement du haut des rochers ? » Alors, je vous assure pour la forme, puisque vous êtes l’actrice principale de ce drame évité, que le garde-chasse ne dira rien de semblable, ni rien du tout, du reste : un peu trop de gnôle de prune locale l’empêchera ce soir d’aligner deux phrases cohérentes.
Malgré le froid, Pauline s’était assise sur la marche du belvédère, tout aux pieds du père Gratien qui regardait droit devant lui droit dans la nuit comme pour y puiser au fond d’un trésor seul connu de lui. Il poursuivit :
- La société occidentale nous a passé un lavage de cerveau. Elle nous a conduits à penser qu’il est nécessaire d’être connu, respectable, apprécié, aimé, d’être important. Elle nous a également inculqué un besoin d’appartenance. Erreur ! Il faut laisser tomber ces illusions pour trouver le bonheur. Nous n’avons qu’un besoin viscéral d’aimer ; non d’être aimé... Le bonheur est un état naturel à notre portée. Il n’est pas indispensable d’ajouter quoi que ce soit à nos vies pour être heureux ; il suffit de laisser tomber quelque chose, de laisser tomber nos illusions, nos ambitions, notre cupidité, nos désirs insatiables. Et tous ces maux nous aliènent par le penchant que nous avons de nous identifier à une série d’étiquettes...
Pauline, merveilleusement bercée par la voix du sage, était loin de se douter que ces dernières paroles qu’elle entendait n’étaient autres qu’une leçon de vie fondamentale, sinon la seule clef pour aborder la vie de pleins pieds et sans illusions... Elle avait fermé les yeux depuis le commencement du discours et lorsqu’elle les rouvrit, le Père Gratien ne brillait plus sous le belvédère. Elle entendit quelques petits froissements dans les massifs de buis, cependant qu’une voix qui s’éloignait dans la nuit, cette fois-ci fraîche de sensations réconfortantes, lui dit comme en passant :
- Demain matin, donnez votre congé à vos actuels peu ragoûtants patrons. Je vous communiquerai l’adresse de ma petite-nièce de Besançon. Elle recherche une apprentie-vendeuse pour son magasin d’antiquités. Elle est veuve depuis longtemps, avec un fils.
Un silence, comme par hasard, avant que le Père Gratien conclut :
- Son fils étudie les Arts Déco.
Parue dans Contes & Nouvelles du Pays Comtois (Editions REPP de Lure, Haute-Saône).
François Couperin - 1ère suite de viole de gambe (extraits).
Coordonnées de l'auteur :
Site allemand JimDo : www.nicolas-sylvain.jimdo.com (lisible sous format PDF)
Facebook : Nicolas SYLVAIN
Tél. 06 73 10 53 42 : tous les jours uniquement de 18h à 21h (heures françaises)