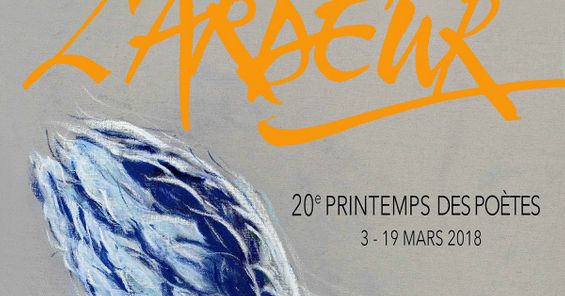GRANDES PAGES
*
Nicolas SYLVAIN
___
GRANDES PAGES
de
POÉSIE
Jean-Baptiste Greuze - "L'Oiseau mort" (1803)
La Jeune fille sur le Seuil
Rêver : pourquoi ? Pourquoi ? Pense Lise, candide.
Un sel adamantin fige les peupliers.
Les marches du perron parcheminées de rides
Congédient Février et ses cariatides :
Le froid, le vent, les nuits aux voilures givrées.
Peut-être, un jour l’hiver jettera sa livrée ?
Enfin, pourquoi rêver ? Il faut vivre au présent,
S’éclore le matin avec pour seul vouloir
La journée s’étirant. Qui peut dire vraiment
Ce qui va se passer dans trois ans, dans un an
Et même dans un mois ? Je ne veux pas savoir.
Oui, pourquoi invoquer l’avenir illusoire ?
L’escalier ancestral porte comme en triomphe
L’adolescente aux joues truitées d’auburn et fraîches,
Ses quinze années en fleurs sur sa tête qui ont *
Filé le diadème de nattes d’un ton
Feuille d’automne roux et qu’envieuses lèchent
L’haleine aigre de l’aube et ses froides flammèches.
Le clocher laisse choir ses neuf heures tremblantes.
Le temps inquisiteur la met au pied du mur,
En capeline mauve Lise est frémissante.
Sur sa bouche blêmit un rictus de mendiante,
Ballerine en sabots, nymphe perverse et pure,
Elle jouera les sphinx avec désinvolture
Mais elle restera la petite indécise,
En jean ce soir, demain en robe hamiltonienne.
Redoutable parfois, d’absolu très éprise.
Entre un passé sous cloche, un avenir de crise.
Mobile de Calder, capricieuse éolienne,
Elle est piéta, Lorette ou reine ou bohémienne.
Alléchée par la sente aux fragrances d’ivresse
Où comme une rosée perle la liberté ;
Courtisée aussi par la nostalgique laisse
D’un quotidien rétro tout ganté de sagesse ;
Elle hésite ou alors, immolant sa poupée,
La chambre conjugale floue sa destinée.
Qu’importe ! C’est demain. La minute qui passe
-Entre l’ondulation des cent peurs étudiantes :
Examens avortés, redoublements de classe-
Accueillera l’amour, sa science qui enlace.
Fi ! Du maintien dévot des refoulées pédantes :
Magnifié le premier amour est d'âme ardente.
Aphrodite curieuse mais jamais vénale,
Elle s’entrouvrira comme l’avide hélianthe
Qui capte sa lumière aurifiant ses pétales.
Elle quête en l’amour un protecteur étale
Mais sachant l’éblouir d’extases violentes.
Pour la carte du Tendre elle s’inscrit partante.
Sa cavale bafoue les écuries d’hier
De ce prince charmant, guindé, seigneur et maître.
Haro sur les idées reçues, les vieux critères !
Qu’il soit mal habillé, au charme de misère,
Que la langue gourmée des gens braves et bêtes
Ride sa renommée et macule ses guêtres,
L’élu des temps nouveaux devra être avant tout
Un compagnon de route, un guide et davantage.
Au musée le pacha, ses rênes, ses licous !
Le guignol imbu de sa primauté tabou
Est vite déchu par la voix qui, sans ambages,
Dit « nous ferons ensemble, et vaisselle, et ménage ! »
Ah oui ! Pourquoi rêver et qu’est-ce qu’un projet ?
Une jonquille d’or chiffonnée par le gel ;
La corde qui se rompt sous le mauvais archet ;
La frêle embarcation naviguant sans agrès,
Et l’espoir qui fait vivre a perdu de son sel.
O ! Bonheur entrevu, arrête ta nacelle !
L’horizon est bouché. Où mènent tes études ?
Violence, pollution et partout injustices ;
Les craintes d’un conflit que personne n’élude.
Pour les quinze à vingt ans les falaises sont rudes,
Comme toile de fond, comme concrets auspices,
La sinistrose des surlendemains se tisse.
Sur les lèvres de Lise un sourire enchanteur
Chasse l’essaim de doutes piquetant son front.
Aujourd’hui Mardi Gras, ses masques de douceurs
Prestement collectés par les gamins frondeurs,
Ses razzias de grenier, trésors de cotillons,
Ses odeurs de beignets dorant dans les poêlons ;
Aujourd’hui Mardi Gras lâchera dans les rues
L’insouciance grimée de l’enfance en goguette.
Lise, retrouve-la cette fougue ingénue,
Fringale d’avenir que l’on croyait repue !
Tout le monde t’attend, ne reste pas seulette,
O ! Troublant chaperon, tire la chevillette !
Clochette de muguet exhalant, cristalline,
Pour l’amoureux des bois tes effluves de sève ;
Mois de Mai qui prodigue une haleine câline ;
Sur l’alpage émeraude, un concert de clarines ;
Au bal du samedi, pourvoyeuse de rêves ;
Douce-amère parfois, mais toujours fille d’Eve :
A quoi me serviraient l’eau de l’étang opale,
La trace d’un oiseau, fine et calligraphiée,
Mes marraines forêts dont je suis le féal,
Le mouvement d’écluse attisant le canal,
Le soleil brisé sur les toits enluminés,
S’il n’y avait tes yeux pour me les expliquer ?
Quel goût aurait le jour, sinon un goût de cendre,
S’il n’y avait ta bouche oxygénant les heures,
Son souffle si mutin et si vert, pour épandre
Des arômes amènes, futés qui engendrent
Une auréole chaude, une aura de douceur,
Transformant l’instant gris en hâle de bonheur ?
A quoi me serviraient toutes ces pages blanches
Où mes doigts esseulés impriment leurs écrits ;
S’il n’y avait ta joue curieuse qui s’y penche,
S’il n’y avait parfois les ombres de tes hanches,
Pour creuser dans mon texte des sillons d’envie
Et pour fondre d’un coup les affres de mes nuits ?
Fille, nymphe ou bien femme, écoute-moi chanter !
Je suis un romantique et un sentimental
Que l’actualité a souvent dévoyé.
Je le redis encor : je suis là des bordées,
Je n’avais plus le temps d’être ton doux vassal,
Désormais je ne veux que toi pour idéal.
Tu es le renouveau, l’aliment de mes yeux,
Oh ! Quel voile les noie, si, ne fut-ce qu’un jour,
Ils n’ont pu s’abreuver à tes regards fougueux,
Ni poursuivre, galants, tes gestes langoureux !
Ils sont tendus vers toi, moirés de chaud velours,
Au seuil de l’avenir, de la vie, de l’amour…
*enjambement de la rime.
(Printemps 1981)
Village de Sibérie sous la neige.
PRIÈRE SANS FRONTIÈRE
(Année 1982)
Au Professeur Jean Bernard
Au nom du délire urémique et de son hoquet de démon ;
Au nom de l’infernal cancer du pancréas qui a jeté
Dans le corps de cette grand-mère un cruel brasero vivant ;
Au nom du vieillard avili par l’inhumaine agitation,
Sanglé aux barreaux de son lit, perfusions, tuyaux dans le nez
Et qui veut s’arracher la vie comme on arrache un pansement :
Oh ! Je t’en prie homme, aie pitié de toi !
Au nom de la quinquagénaire, au regard délavé, qui meurt
De métastase cérébrale et d’un néo cloué au sein,
Dont nul ne prend la main crispée par trop de mouvements cloniques ;
Au nom de ce prématuré stagnant dans son incubateur,
Fragile et émouvant trésor de cristal qu’un tout petit rien
Peut rejeter dans le néant ou dans des cieux problématiques :
Oh ! Je t’en prie homme, aie pitié de toi !
Si pour l’œuvre du communisme il nous fallait exterminer
De la population, les neuf dixièmes, nous ne devrions
-Disait Lénine – reculer devant l’important sacrifice ;
Au nom des cinquante millions de vies, par Staline, fauchées ;
Et au nom des martyrs de la bolchévique révolution,
Qui, depuis dix-neuf cent dix-sept, lardent le siècle de supplices :
Oh ! Je t’en prie homme, aie pitié de toi !
Dans le complexe de Potma, en Mordovie loin de Moscou,
Quatorze camps échelonnés sur cent kilomètres le long
D’une voie ferrée sans issue propriété du K.G.B….
Vaste comme six fois la France un complexe est encore plus fou :
Kolyma, crématoire blanc aux monstrueux hivers sans fond.
Au nom des bagnards entassés par moins cinquante-cinq degrés :
Oh ! Je t’en prie homme : aie pitié de toi !
Et puis à Tachkent, en été, par quarante degrés à l’ombre,
Combien d’immeubles sont construits par des femmes – ce n’est pas rare ?
Tandis qu’à côté les chauffeurs de taxis ouzbecks font la sieste !
Elles sont manœuvres, forçats, moins que prolétaires : des nombres…
La femme est le mulet de l’homme, a dit un proverbe tartare.
Au nom de ces êtres de somme et de leur vie saignée à l’Est :
Oh ! Je t’en prie homme : aie pitié de toi !
Depuis le dix-huitième siècle et le partage du pays,
A toutes les générations la Pologne a connu la guerre,
Ses hommes trop souvent partis en prison, au bagne, aux combats.
La femme a dû vite endosser sa carapace d’énergie.
Au nom de Wanda internée, une nuit du tragique hiver,
Et dont les enfants sont jetés dans un lugubre orphelinat :
Oh Je t’en prie homme : aie pitié de toi !
Pauvres Wanda, pauvres Lydia, le Kremlin a joué gagnant !
A l’égard de votre patrie les bons sentiments gratuits seuls
Ont fait grande unanimité : près de six cents ordinateurs
Font tourner en URSS jusqu’aux usines d’armement.
Ils sont gages de l’Occident. Au nom de vos pionniers qui veulent
Voir, dans nos pays, condamner les impostures des hâbleurs :
Oh ! Je t’en prie homme : aie pitié de toi !
En juillet soixante-dix -neuf, un cargo grec, le Klearchos
Sombrait dans le golfe d’Olbia, au grand large de la Sardaigne.
Fait divers ? Non, vrai cauchemar quand l’inventaire fut connu :
Perchlorétylène, arsenic, des tonnes de cocktails atroces…
Au nom des pêcheurs retirant dans ces eaux où la mort se baigne
Des centaines de poulpes morts, mille autres poissons corrompus :
Oh ! Je t’en prie homme : aie pitié de toi !
Budget pour l’armement, bien sûr, et pour la défense intérieure.
Pour la Recherche qui mendie le budget n’est pas garanti,
Et la Santé fait le trottoir, l’avenir suspendu aux langues
Des ronds-de-cuir du Parlement qui accouchent avec lenteur
D’un chiche secours sur lequel « ne pas dépasser» est prescrit.
Au nom de la mère veillant son enfant squelettique, exsangue :
Oh ! Je t’en prie homme : aie pitié de toi !
Mi-février quatre-vingt-deux, la Roumanie a augmenté
Soudain de trente-cinq pour cent toutes denrées alimentaires.
Penché sur sa feuille d’impôts, le Français moyen se rassure :
Traitement et voiture en double et la maison neuve à payer ;
Grands dieux le Changement rendra moins dur de rester prolétaire !
Au nom des enfants sacrifiés aux violents marasmes futurs :
Oh ! Je t’en prie homme, aie pitié de toi !
Au nom de la France lucide et vraie patrie des Droits de l’Homme ;
Au nom de ce mot Liberté le seul véritable idéal,
Quand tu ne le prostitues pas aux pieds des causes fallacieuses ;
Au nom de la Science et des Arts et de leur fabuleuse somme,
Enviés par les nations et qui leur servent souvent de fanal ;
Au nom de ta France sortie, de tous les périls, victorieuse :
Oh ! Je t’en prie homme, aie confiance en toi !
Le Mur de Berlin que je franchi en Mars 1971.
VOYAGE EN PAYS DE DĖTRESSE
Mon cœur ne perçoit pas que les fleurs de l’amour,
Que les jupons de rêve aguichant la tendresse.
Dans mon ciel la beauté ne luit pas tous les jours.
Je foule des chemins empierrés de tristesse
Où mes semblables vont, tête basse et cœur las,
Vers un futur où grêle la déconvenue.
Je n’ai pas de fanal et il fait nuit déjà.
Ah ! Pauvres gens lorsque vous avez disparu :
Mes yeux n’ont pas cillé et mon cœur a compris.
De plus en plus souvent mes yeux pen-sent au loin.*
Ils pen-sent vif et long et les fibres d’hier
Les ti-en-nent axés sur un mythique point.
Le passé paraît tant voilette de poussière
Qu’il me faut parfois le secours du passeport.
Et je revois des trains qui pour-fen-dent la nuit.
J’ai bien vécu cela, oh ! Non non rien n’est mort,
A chaque fron-ti-ère accordant son permis :
Mes yeux n’ont pas cillé et mon cœur a compris.
« Blumen » était inscrit sur le mur de Berlin,
Ce magasin de fleurs rasé à mi-hauteur,
Fané, vi-o-lé par le rempart du destin
Tout enlaidi de honte accusait le malheur.
Quand j’ai vu écrit comme un regret lapidaire
Pour qu’on ne l’oublie pas et qu’on l’immortalise,
Au beau milieu d’u-ne couron-ne mortuaire,
Ces pauvres mots lavés : « Für immer Annelise »**
Mes yeux n’ont pas cillé et mon cœur a compris.
Pour pouvoir regagner ma chambre à Budapest,
Je posais un forint entre les mains ridées
De ma logeuse exsangue et au souffle funeste.
Fa-mé-li-que tarif pour avoir droit d’entrée.
C’était ma foi le prix d’un ver-re de vin chaud
Sur les quais de la ga-re de Nyugati Piu.
Je sentais
ses poumons comme pris dans l’étau
Et lorsque j’ai quitté son regard bleu dissout :
Mes yeux n’ont pas cillé et mon cœur a compris.
Un être vit et puis un autre est là qui veille.
Je suis dans l’ombre, Edith, je t’en prie n’attends plus !
Marie-toi sois heureuse avant que d’être vieille !
En Roumanie sera mon grand amour perdu.
Quand ba-fou-é par notre impitoyable monde
Dans la nuit de Novembre, il y a si longtemps,
Le train m’a arraché à ta tendresse blonde
Et que ce réveil vide a tué mes vingt ans :
Mes yeux n’ont pas cillé et mon cœur a compris.
Quoi que di-sent de moi les saints-Jean-Bouche d’or
Ah ! Non je ne suis pas disciple de Narcisse.
Mon miroir est sans tain, j’écoute quand tout dort.
Dans les larmes souvent ma plume navrée tisse
Les mots appréhendés aux quatre coins des rues.
Je suis votre témoin et votre journaliste.
Lorsque face au malheur votre bouche s’est tue,
Qu’apparemment je suis resté bêtement triste :
Mes yeux n’ont pas cillé et mon cœur a compris.
Je pense à Géraldine en ce matin d’automne,
Violée, tuée, jetée dans les eaux d’un canal
Et son cercueil suivi par cinq mil-le personnes.
Oui, on tue les enfants, ces temps-ci, c’est banal !
Ou alors c’est Francine en son vingtième été
Qui prend la route avec la mort dans sa voiture.
A son en-ter-re-ment je ne suis pas allé.
Peine inavouée se cache et je ne suis pas dur :
Mes yeux n’y étaient pas mais mon cœur a compris.
Puis c’est de leur vivant qu’on s’intéresse aux gens.
Brassens avait raison de dire « au ci-me-tière
Ah morbleu ! Il n’y a per-son-ne là-dedans ».
L’esprit, l’âme, l’aura ne restent pas en bière.
Les disparus sont pro-ches - ça qu’on le comprenne –
De nos petits soucis, nos occupations graves.
Et si pour nous la vie est souvent u-ne chienne,
La sérénité est leur lot car eux ils savent :
Mes yeux l’ont supposé mais mon cœur l’a compris.
Finalement pour nous, les êtres bien en chair,
Ne som-mes-nous pas des produits artificiels ?
Avec notre savoir infus et nos grands airs
Qui condamnons très sûrs l’Au-delà et le Ciel.
Nous croyons pour de bon, posséder la sagesse,
Saisir l’irrationnel, vivre les pieds sur terre.
Notre pas nous entraîne en pays de détresse
Et tous nos fiers concepts, ah ! Voyons comme ils errent :
Mes yeux sont désolés et mon cœur a compris.
Toi la femme vendue par un pieux ma-ri-age
Qu’un pacha qui s’ignore immole dans son lit,
Tu as souvent crié : « assez de ruts en rage,
On peut fai-re l’amour avec les yeux, l’esprit
Avant de rouler dans de porci-nes bordées ! »
Mais il n’a vu en toi qu’une viande à plaisir.
Quand j’ai rencontré ta qua-ran-taine fripée
Et ton visage éteint qui ne sait plus s’ouvrir :
Mes yeux n’ont pas cillé et mon cœur a compris.
Tu as l’â-ge du Christ, bru-ne fleur enivrante.
Com-me croix tu auras la chimiothérapie,
Peut-être pour calvaire u-ne fin lancinante,
Nul ne sait mais déjà ils ont tressé ta nuit
Les bien portants ravis et orgueilleux de l’être.
Ils le fuient ton cancer mais ça les sécurise,
Ils te ferment leur porte et voi-lent leurs fenêtres
Sur leur tumeur maligne : une infecte bêtise.
Mes yeux sont embués et mon cœur a compris.
J’invi-te parvenus, sectai-re-s et faquins,
Bourgeoi-ses, cœurs suris, minettes dont le lot
N’est que pré-ten-ti-on, malice et fond de teint ;
A rendre une visite au Grand Champ des Sanglots
-Au Champ du Grand Repos et du Dernier Silence-
Pour que l’angoisse enfin nécrose l’artifice,
Les pas-se-men-te-ries de leur vai-ne sci-ence,
L’arrogance de leur humanité factice :
Ah ! Mes yeux l’ont jugée et mon cœur a compris.
*Typographie syllabique de certains mots pour inciter à la véritable diction (respect de la longeur du vers)
**Pour toujours, Anne-Lise.
*
LA TOILE ĖCRUE
Je suis un peintre de la rue
Et la palet-te de ma vie
Jet-te sur une toile écrue
Des couleurs que le vent délie.
Inquisiteur des indolents
Au devoir grégaire et stérile,
Je croque au milieu des passants
La veu-lerie, l’instinct puéril.
Débusquer la réalité
N’est pas vertu de quiétiste,
Je n’ai pas à le déplorer
Moi le bretteur idéaliste.
Le monde au seuil de ma trentaine
Darde ses ron-ces d’injustice,
Je voudrais souffler une haleine
Qui l’épure et qui l’embellisse.
Avec l’orage à ma fenêtre,
Comment puis-je entonner serein
Une ode à la jouis-san-ce d’être
Ou de gentils alexandrins ?
L’humanité est un vitrail
Captant aussi lumiè-res vives,
Mais trop souvent mon cœur défaille
Voilé par tant d’ombres lascives.
A quoi bon remercier le Ciel
Pour ses dons coutumiers fortuits
Lorsque la presse universelle
Com-men-te la guerre à mon huis ?
Une action de grâce est plaisante
Le calme béat tranquillise.
La révolte est plus exigeante
Qui bannit leurre et cou-ardise ;
Qui souffle dans son éteignoir
Sermons, boniments de pierrot.
Enfin choisir il faut savoir
La lutte ou bien l’opium des mots.
Noirs ne sont pas tous les destins,
Des hommes sont heureux, parole !
Mais par devoir tant de faquins
Sourient pour masquer leur vérole ;
Salauds, crient aux nécessiteux
Pour se donner bon-ne conscience :
« Vous n’ê-tes les plus malheureux
Allons, ingrats, de la décence ! »
Ah ! Nul ne peut rien pour personne
Sauf bien sûr donner de l’argent.
Que d’humanistes déraisonnent
A n’octroyer que boniments !
L’homme encor se nourrit de soupe,
Les fioritu-res du langage
Lui propo-sent vide u-ne coupe
Séchant l’esprit, le cœur de rage.
La justi-ce n’est d’aucun monde
-jamais nous ne la croiserons-
Et l’impuissance est à nos frondes
Qui toujours vai-nes siffleront.
Sans répit je tendrai le poing
Aux moutons de Panurge, aux neutres,
Aux Bons apôtres sibyllins,
Aux boute-feu qui se calfeutrent.
Le vent se lè-ve sur ma route.
Mon havresac de mots qui rongent
Te tritu-re, mon cœur qui doute.
Et cependant ivre tu songes.
Le monde est une toile écrue
Et la palet-te de ma vie
Tente de sauver dans la rue
Des couleurs que le vent délie.
Octobre 1981.
Dans le bois des Vernaux à Tavaux (Jura)
LES ÉCRITS QUI S’ÉCRIENT
Mes écrits sont pour m’écrier,
Sans bruit, sans odeur et discrets,
Puisqu’ils s’écrient sur le papier.
Le lecteur, seul, en a l’accès
Mes écrits sont pour m’écrier
De la manière haute et racée,
Dans le silence et sans crier.
Ma plume est occulte et madrée.
Mes écrits sont pour m’écrier
Loin de la foule aigre et paillasse.
Indépendant je puis tracer
Bien des mots quel que temps qu’il fasse.
Mes écrits sont pour m’écrier
Hors témoin, complice ou larron.
C’est toujours sans m’égosiller
Que je versifie mes chansons.
Mes écrits sont pour m’écrier
Sans le moindre son, sans micro.
Nul ne peut donc me décrier
Pour monopoliser l’écho.
Mes écrits sont pour m’écrier
Dans la retraite et sous les cieux.
C’est aussi façon de prier,
Pour moi, le si bienveillant Dieu.
Mes écrits sont pour m’écrier
Loin de l’encens, des ostensoirs.
Je puis donc évangéliser
Et porter les athées à croire.
Mes écrits sont pour m’écrier
Loin des salons, des dédicaces.
Amusé, je vois roucouler
Les tenants teigneux de la place.
Mes écrits sont pour m’écrier
Sur le Net international.
Je laisse aboyer, pontifier
L’élu d’académie locale.
Mes écrits sont pour m’écrier
Par l’encre ou par le numérique.
Je reste actif à m’adapter,
Vif, aux révolutions techniques.
Mes écrits sont pour m’écrier :
Vive et vienne, attendu, le Monde
Nouveau pour tout améliorer ;
Reprenez cet air à la ronde !
Mes écrits sont pour m’écrier :
Silence au racisme autochtone !
C’est le temps d’aimer, d’implorer ;
Le courroux de Dieu déjà tonne.
Mes écrits sont pour m’écrier :
Je mets le cap sur l’Algérie,
Mon destin va me conforter
Dans cette évolution de vie ;
Mes écrits sont pour m’écrier :
Mes mots ont l’ordre de servir.
Prose et poésie vont œuvrer
Pour, à ce devoir, parvenir.
Mes écrits sont pour m’écrier :
Je suis un heureux paresseux ;
L’essentiel va me programmer
Plus utile en écrivant peu.
Mes écrits sont pour m’écrier
Sans frontière et sans étiquette.
Ne pas me taire et vous aider :
Ami(e)s d’Algérie, c’est ma quête !
Pour que mieux mes écrits s’écrient,
Je me réserve et me préserve
Dans la forêt, mon Paradis,
Afin que, Sylvain, mieux je serve.
Tavaux, Bois des Vernaux, Août 2017.
*